658e exercice d’écriture très créative créé par Pascal Perrat

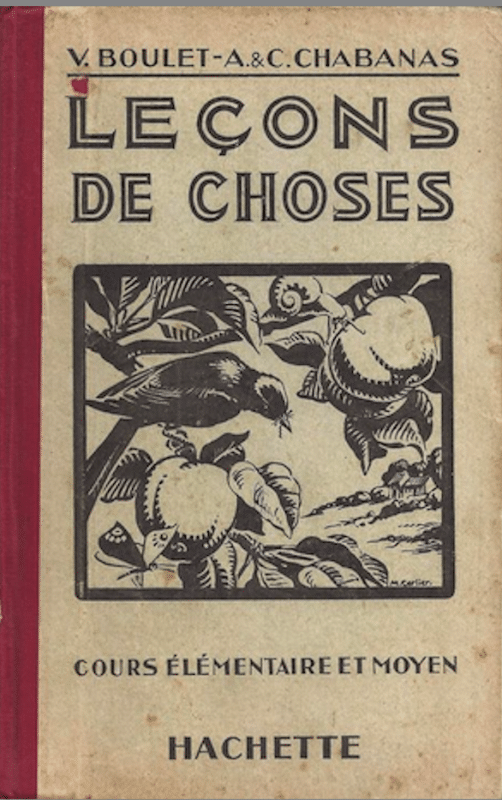
Racontez cette fois où votre regard s’est posé sur un objet et ne l’a plus quitté. Cet instant où il vous fut impossible de résister à l’envie de le posséder. L’irrésistible pouvoir qu’il exerça sur vous.
(Méfiez-vous, cela arrive souvent pendant les vacances 🙃)
Recevez la compilation de 750 exercices d’écriture créative publiés sur ce blogue depuis 2009. Pour l’obtenir au format PDF, faites un don de 15 € à l’association Entre2lettres. Pensez à préciser votre demande d’exercices, vous recevrez un lien pour la télécharger. FAIRE UN DON À L’ASSOCIATION.
SANS VOUS, CE BLOGUE N’EXISTERAIT PLUS. DEVENEZ MEMBRE BIENFAITEUR. FAITES UN DON À L’ASSOCIATION ENTRE2LETTRES ®


Son regard et sa position lascive ne me quittent pas de la journée. Il ne se trouve pas sur mon chemin habituel, j’aurais pu ne pas le rencontrer. Mes pas m’ont mené là par hasard.
Au dîner, je suis volubile, j’essaie de partager tout ce qui se bouscule en moi. À part quelques questions, par gentillesse, personne n’est vraiment intéressé.
Cette nuit-là, je dors mal. Je dois retourner le voir, il me fascine. J’adore sa couleur si bizarre.
Deux jours passent sans qu’il me soit possible de changer mon itinéraire malgré ce regard magnétique que je ressens comme un appel.
Enfin, me voilà devant la vitrine de la galerie avec ce léopard aux taches bleues, alangui dans le creux en V que forment deux branches noueuses d’un arbre imaginaire. Il se sent en sécurité, il peut s’abandonner. Il me suit des yeux, serein. Comme je l’aime !
– Je te vois bien à la maison, juste à l’entrée. Chaque fois que j’ouvrirais la porte, tu m’accueillerais avec ta nonchalance qui inspire au calme. Bien que ton regard soit légèrement dans le vague, il me fascine. J’ai l’impression que tu veux communiquer.
L’attraction est si forte que je finis par changer ma routine pour passer devant la vitrine le plus souvent possible et l’admirer, jusqu’au moment où je décide de l’acheter.
J’entre dans la galerie au son d’une clochette accrochée à la porte et demande le prix. Il est correct, rien à dire, mais je n’ai pas vraiment l’intention de dépenser cette somme.
La semaine passe, le léopard bleu me trotte toujours dans la tête, je continue d’en parler à la maison. Tous finissent par me dire :
– Ben va l’acheter ! Fais-toi plaisir !
Ils ont raison. Ce sera aujourd’hui ! Journée pourrie. Rien ne fonctionne au bureau ! Une cascade ininterrompue de problèmes que je règle au mieux et surtout rapidement, tant je suis pressée d’aller chercher mon magnifique léopard bleu.
Tintement de la clochette accrochée à la porte de la galerie :
– Bonjour, madame ! je viens acheter le léopard bleu qui était depuis plusieurs jours en vitrine.
– Je suis désolée, madame, je l’ai vendu ce matin.
Anéantie, je la remercie et pense immédiatement à un voyage en Russie. Nous étions, avec mon mari, dans un restaurant, lorsqu’étonnamment un vendeur arrive poussant un chariot débordant de babouchkas, de livres, de disques et autres souvenirs. Après l’effet de surprise, je choisis un châle très coloré et puis je me rétracte en pensant que nous ferons tous les achats en même temps à la fin de notre séjour. Il y a longtemps, ce n’est plus très clair, mais ce dont je me souviens, c’est la réponse du vendeur à mon refus : « Prenez-le, madame, vous n’êtes pas sûr de retrouver le même ». J’ai souri et suis restée sur ma position. Il avait raison, je ne l’ai pas retrouvé ailleurs. La vie me l’a souvent prouvé et une fois de plus, j’en fais l’expérience.
Triste, le regard du beau léopard bleu ancré dans ma mémoire, je rentre chez moi maudissant cette journée ! J’ouvre la porte de mauvaise humeur en imaginant comme j’aurais aimé le voir là, en face de moi, m’accueillant de son regard si vivant. Encore une fois, j’aurais dû écouter ce Russe plein de sagesse !
Exactement, à l’endroit où je rêvais qu’il soit, il est là, et me sourit presque. Cadeau-surprise de mon époux !
Nous étions trois frères. La même mère. Trois pères différents. C’est sans doute cette incongruité aux yeux des autres qui a resserré nos liens. Je vous présente Roger l’ainé dit Roro par la bande d’idiots de l’école, puis Lucien dit Lulu par la bande de cafards du village, et votre serviteur Fabien, le dernier-né, dit Fafa par tous ces imbéciles dont l’imagination n’était pas au zénith.
Pour éviter les méchancetés verbales et physiques, nous avions appris à éviter cette vermine.
Nous nous réfugiions dans le bois derrière chez nous. Nous avions construit des cabanes dans des arbres aux feuillages denses. Impossible de nous trouver. Nous étions les rois des hauteurs.
Un jour, on découvrit par hasard l’entrée d’une grotte. Nous y pénétrâmes en rang serré et à pas de louveteaux. Nous gagnions peu à peu du terrain avec de moins en moins de clarté. Et quand nous entendîmes un bruit étrange, la peur nous a fait faire un demi-tour de panique et c’est ainsi que je me suis pris les pieds dans un infame chiffon. Lucien et Roger freinèrent des quatre godillots pour secourir leur petit frère.
Mes sauveurs me découvrirent en train de contempler ma main. Ils crurent que je m’étais blessé et entendaient déjà les cris de notre mère. Seulement, je n’arrivais pas à détacher mon regard de cet objet insolite. Il exerçait sur moi un tel pouvoir que je n’autorisais pas mes frères d’y toucher. Ce fut notre première mésentente.
– Eh Fabien, je suis sûr que tu ne sais pas ce que c’est ! dit Roger.
– Si tu nous prêtes ton trésor, je te montrerai son fonctionnement, dit Lucien.
– Et patati
– Et patata…
Je ne les écoutais pas. Même ma mère ne parvint pas à me faire changer d’avis.
Dépités, ils m’ignorèrent. Partaient à l’aventure sans moi. Je finis par tomber malade.
– Fais un effort, mon bébé ! Tes frères ne veulent pas prendre ton bien, mais seulement te faire découvrir le fonctionnement de celui-ci.
Ainsi fut fait ! J’étais subjugué par cette découverte. Et nous reprîmes nos pérégrinations…
L’hiver suivant fut terriblement froid. Roger et Lucien furent très malades. Je leur donnais mon trophée pour les aider à survivre mais ils succombèrent.
Quelques semaines plus tard, le curé rendit visite à ma mère.
– Mais que fait donc Fabien ? Que regarde-t-il avec tant d’insistance ? Il n’est pas malade au moins ?
– Ne faites pas attention, Monsieur Le Curé, il est tout simplement…déboussolé !
Je déambulais entre les gondoles de L’Encre sympathique, vieille libraire-papeterie de mon quartier, lorsqu’un objet attira mon attention.
Poussiéreux et vétuste, il semblait relégué dans le recoin d’une étagère où somnolaient les œuvres d’écrivains tombés en disgrâce ou dans l’oubli et des plumes Sergent-Major et autres articles de l’école d’autrefois.
C’était un pèse-lettres. Il me fascina d’emblée car dès que je le vis, je compris qu’il m’était destiné.
Car il pouvait enfin m’apporter la solution à cette énigme existentielle pour moi, la réponse à cette question qui me hantait depuis trop longtemps.
Pourquoi toutes ces lettres que j’ai envoyées et restées lettre morte
– Cette demande dégrèvement à l’Administration fiscale
– Cette sollicitation auprès de mon bailleur pour un allègement des charges
– Ma demande de mise à la retraite anticipée suivie de ma lettre de démission
– Ces courriers recommandés retournés « Non réclamés par le destinataire »
– Ces lettres d’amour exprimant en lettres de feu mes sentiments les plus ardents, mes élans les plus enflammés
– Ces trop nombreux courriers revenus avec la mention « Destinataire inconnu » ou « N’habite pas à l’adresse indiquée »
J’ai appris dans la vie à peser mes mots, à mesurer mes propos, à appliquer les consignes de la syntaxe et de l’orthographe à la lettre.
Mais quel poids avaient mes lettres pour ne susciter qu’indifférence, silence et dédain? Ce pèse-lettres m’aurait bien renseigné, j’en étais convaincu
Toutefois, un courrier, pour lequel je n’attendais pas de réaction car cela relevait de l’impossible, m’est revenu
C’est cette lettre anonyme que j’ai adressée à mon ennemi juré avec pour entête « Au roi des cons »
Racontez cette fois où votre regard s’est posé sur un objet et ne l’a plus quitté. Cet instant où il vous fut impossible de résister à l’envie de le posséder. L’irrésistible pouvoir qu’il exerça sur vous.
– Quoi elle n’est pas encore arrivée la pipe en ivoire que j’ai commandée il y a plus de 9 mois.
Nom de dieu regardez bien la liste des commandes, je me dénomme Magret de Canard, 11 rue du Paradis, Paris 10ème arrondissement.
Je veux ma pipe, sinon je casse tout dans cette boutique.
– Monsieur calmez vous, on ne vend pas de pipe ici.
Vous vous appelez Magret et vous venez de la rue du Paradis. Que c’est drôle !
Ici, vous y êtes déjà au paradis, au paradis blanc comme dans la chanson de Michel Berger.
– Paradis, paradis …
– Ben oui monsieur, toutes les personnes qui sont ici, que vous voyez, dans la rue, les maisons … sont toutes des défuntes, toutes sur Terre elles sont passées de vie à trépas.
Maintenant dans ce formidable pays elles profitent d’un long séjour éternel.
– Que me racontez-vous là ?
Je viens chez vous pour récupérer la pipe que j’ai commandée et vous me sortez toutes ces salades de paradis.
– Zen zen monsieur, regardez dehors dans la rue. Vous voyez ces grandes affiches.
– Oui oui.
– Vous voyez ce qui est écrit dessus.
– Oui oui, paradis, paradis, plusieurs fois.
– Voilà nous y sommes. Je vous le répète vous n’êtes plus une personne vivante.
Vous avez cassé la pipe, vous comme moi, et tous les gens que vous verrez ici.
Fini, fini, nous avons tous cassé la pipe.
– Arrêtez de vous f. de ma gueule.
Oh regardez dehors ! Qui passe dans la rue.
Cest lui pardi marchant sur le trottoir.
J’en suis sûr. C’est le commissaire Maigret en personne.
Je le reconnais.
J’ai lu la quasi-totalité des livres de George Simenon. Vous connaissez cet auteur ?
– Je ne le connais pas monsieur.
Moi sur Terre, j’ai longtemps vécu en Bolivie et je lisais très peu. Sauf les bouts de papier avec l’énoncé des courses au supermarché, que je faisais tous les samedis avec ma femme.
– C’est lui vous dis-je !
Vite je sors, je vais à sa rencontre !
Je vais lui demander s’il a une pipe à me prêter !
– Ah, ah allez le voir et ne revenez
plus ici !
– Hello bonjour monsieur Maigret. J’espère que c’est bien vous.
– Bonjour, n’ayez crainte c’est bien lui ; le commissaire Maigret en chair et en os.
Que puis-je pour votre service.
– Heu heu … monsieur, vraiment désolé. J’ai un service à vous demander.
J’ai un gros besoin en ce moment.
Sur Terre c’était plus qu’un vice. J’étais un gros fumeur.
Dans ce foutu pays c’est la croix et la bannière pour en trouver.
Je cherche une pipe. Une vraie.
Le summum serait une en ivoire. Hi hi.
– Voilà fiston fit le commissaire.
Il m’en reste une justement en ivoire.
On me l’a offerte pour mes cinquante ans.
– Oh merci monsieur. C’est vraiment cool de votre part.
Mon rêve est exaucé. Voilà que j’ai une pipe, pour moi tout seul.
Il y a tellement de temps que je voulais en posséder une, dans ce repère d’immortels à la gomme.
Je vous remercie une nouvelle fois, monsieur Simenon.
– Ce n’est rien fiston. Des pipes et tabac,
j’en ai toujours sur moi. Ça peut dépanner.
– Pour moi monsieur c’est vraiment le plus beau jour de ma vie éternelle, Ah ah.
– Maigret reprit :
Surtout cette pipe en ivoire ne l’égarez pas.
Regardant sa montre à gousset, il ajouta.
Fiston j’ai un peu de temps de libre. Venez je vous invite chez Germaine, un café pas loin d’ici, où on pourra prendre une ou deux bières fraîches ; il fait tellement chaud ici …
658/Racontez cette fois où votre regard s’est posé sur un objet et ne l’a plus quitté. Cet instant où il vous fut impossible de résister à l’envie de le posséder.
C’était un lundi matin. Nous venions d’entrer en classe et attendions notre Professeur. C’est alors que mon voisin déposa sur son bureau un stylo 4 couleurs . Cela faisait des semaines que je rêvais d’n posséder un, mais mon père était inscrit à Pôle Emploi depuis un certain temps et il fallait que je sois raisonnable disait-il. J’avais la certitude que si j’en possédais un j’aurais de meilleures notes.
Soudain mon voisin m’en tendit un en m’expliquant qu’il en avait plusieurs car Carrefour en donnait aux clients dont le ticket de caisse dépassait les 100 E. Je le remerciai en lui disant que je lui revaudrais çà.
Ai-je de meilleures notes ? Un jour oui, un jour non ! Mais j’ai un nouveau copain « à la vie à la mort » ……… ;
J’étais un jeune papa qui n’avait pas beaucoup d’argent. Je roulais dans une Peugeot 504 qui n’avançait pas mais qui me permettait de me rendre au travail. Et puis un jour que je me promenais au bras de mon épouse et de ma fille aux yeux coquins, je la vis. Sur le bord de la route, dans le parking d’un vendeur de voitures d’occasion, elle était là, toute de gris métatalisé revêtue. Une BMW 323 injection. Bah ! Bah ! Ba ! J’avais les yeux qui papillonnaient. Bien sûr le gris devenait un peu mat sur le capot avant. Bien sûr elle n’avait que deux portières. Mais elle semblait m’appeler : « Alain, écoute tes rêves. Fais-toi plaisir. Achète-moi ». Elle avait des arguments. Principalement son prix : 4 000 francs. Neuve elle en valait 20 fois plus. Marie me regardait. Elle lisait mon envie dans mes gestes empruntés lorsque je tournais autour d’elle. Je la caressais, je reluquais son derrière et ses amortisseurs. Faut dire qu’elle n’était pas toute jeune madame BMW. 150 000 kilomètres. Elle en avait roulé du bitume. Mais ça n’était pas grave. Je savais son moteur increvable. Un rêve : propulsion 13 chevaux. Je galopais déjà sur les chemins escarpés, serrant le volant comme on dompte une crinière. J’étais parti, j’étais dans un autre monde. Soudain, j’entendis une voix :
– Tu la veux ?
– Hein, quoi, la voiture. Ah, oui, bien sûr. Mais ce ne serait guère raisonnable. On n’a pas les 4 000 francs.
– On a 2 000. Avec un petit crédit, ça va le faire. Je serais tellement heureuse de te voir la conduire.
– Ma chérie, je t’aime.
Lorsqu’elle nous vit dans les bras l’un de l’autre, ma fille Anne nous enserra de ses petits bras. Elle ne comprenait pas mais savourait notre fusion. Notre joie était devenue la sienne. Lorsque le vendeur me fit m’assoir dans le siège enveloppant, j’eu une bouffée de plaisir qui me donna des couleurs. Ma main effleura le cuir râpé de son volant :
– Ma Titine, je volerai bientôt avec toi, lui dis-je.
Le vendeur avait tellement lu d’envie dans mes yeux qu’il fut difficile d’obtenir une ristourne. Il nous offrit la carte grise et un plein d’essence. Une semaine plus tard et un crédit en plus, je pris les commandes de « Titine ». Jamais je n’ai été si heureux. Je la gardais jusqu’à ce que notre 4ème enfant nous contraigne à passer à un modèle plus grand. Je versais une larme lorsqu’il fallut la céder au concessionnaire en échange d’un modèle beaucoup moins sexy. Quelques jours plus tard je discutais avec le mécanicien qui avait conduit « Titine » jusqu’à la Casse. Il me dit :
– Putain. Elle en avait dans le ventre votre BM. Je me suis fais plaisir sur la route menant à la Casse. Je n’en croyais pas mes sensations. Bien conservée, la vieille. Ca m’a fait quelque chose de la conduire à sa dernière demeure.
J’en rêvais depuis plus de vingt ans après l’avoir vue chez un antiquaire, mais elle était trop chère pour moi à l’époque.
Ronde, pas trop grosse, afin de tenir exactement dans le creux de la main, pas avec n’importe quel sujet, celui, bien précis, qui me tenait au coeur et à l’âme.
J’en ai vu des centaines au cours de mes voyages, mais il manquait toujours quelque chose.
J’ai cru la trouver une ou deux fois , c’était juste une pâle imitation, falote, grossière. J’ai cherché dans les musées, les magasins de curiosités, les vides greniers, sur le bon coin, toujours en vain.
On a essayé de m’en fourguer à coups de :
– Mais regardez, celle là s’en approche.
– J’en avais une mais je l’ai vendue avant hier, si jamais j’en retrouve, je vous tiens au courant »
Une nouvelle voisine est venue s’installer dans l’appartement du rez de chaussée de mon immeuble. Une charmante vieille dame qui m’invita à prendre le thé afin que nous fassions connaissance.
Nous bavardâmes agréablement, elle avait la vue faible et l’ouïe déclinante, se déplaçait avec difficulté. Elle me demanda d’aller chercher un album de photos pour me présenter sa famille.
– Il est dans le premier tiroir de la commode, à côté du radiateur ».
Je me dirigeais vers le meuble et là, je vis, couverte d’une légère couche de poussière, la huitième merveille de mon monde, la boule à neige, exactement celle dont j’avais fait ma passion.
Sans réfléchir à la portée de mon acte, je la glissais dans une de mes poches puis revenais avec l’album demandé. Le coeur battant, j’écoutais à peine ce que disait ma voisine, caressant du bout des doigt mon larcin.
Revenue chez moi, j’admirais la boule qui brillait maintenant dans ma main. Je me promit de la remplacer par une autre, quelconque, ce qui ne ferait, pour la vieille dame, aucune différence.
Vint Noël, je l’invitais à déjeuner, elle avait un cadeau pour moi.
– J’ai cela chez moi depuis longtemps, cela me fait plaisir de vous l’offrir, dit elle en me tendant un paquet rond maladroitement enveloppé
» Ma » boule à neige avec le même sujet que la sienne mais sans élégance aucune.
J’espère encore qu’elle ne m’a pas vu rougir d’une telle honte !!!
Belle histoire
Un jour de pluie, pour passer le temps, Mémé Germaine avait déniché au fond de son placard une boite à biscuits dans laquelle elle conservait quelques photos. Tout émue, elle me tendit sa photo de mariage. Je n’avais guère prêté attention à ce cliché sépia, sinon que ma grand-mère ressemblait à une sultane avec ce bandeau qui lui barrait le front et que son mari m’avait semblé bien sévère. « C’est ton Pépé », m’avait-elle dit, des trémolos dans la voix.
Bien des années plus tard, j’aurais tant aimé garder un souvenir de mes grands-parents au temps de leur bonheur. Ce n’est qu’en grandissant, en mûrissant, que je compris que le chemin de vie de ma grand-mère n’avait pas été pavé de roses. Mariée à vingt ans, veuve à 27, enceinte de son cinquième enfant, bonne à tout faire pour les élever. Mais, que sait-on de tout cela quand on n’a que huit ans ?
Un après-midi, alors que je lui rendais visite dans son mouroir, je lui demandai à revoir cet objet. Après l’avoir trouvé dans sa boîte à gâteaux, elle me le tendit et m’en fit l’offrande.
Je crois que nous sommes la dernière génération à conserver des photos dans une vieille boite à gateaux.
Elle était rouge, évidemment, un rouge vif, rutilant, qui s’accordait à merveille avec le chrome argenté des jantes de ses deux mini-roues, équipées de vrais pneus dont l’épaisseur garantissait une excellente tenue de route. Elle trônait dans la vitrine d’un magasin de jouets et j’en étais tombé littéralement amoureux ! Chaque jeudi, je passais devant cette vitrine pour me rendre chez ma grand-mère et je m’attardais pour contempler l’élue de mon coeur durant de longues minutes. A l’école, tandis que la maîtresse s’efforçait de nous inculquer l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir, la règle de trois et tutti quanti, je m’évadais en rêveries où je roulais avec ma bien-aimée sur les allées du parc public, sous le regard admiratif des autres enfants. Le soir, avant de m’endormir, je parcourais avec Elle une piste goudronnée qui longeait une falaise abrupte au bord de la mer, ou bien s’enfonçait dans une forêt verdoyante…
Début décembre, Elle était toujours dans la vitrine et les petites fleurs clignotantes d’une guirlande électrique lui faisait une parure assortie à ses charmes. Plus amoureux que jamais, je composai ma lettre au Père Noël et j’osai La mentionner en tête de liste. Il n’y avait plus qu’à attendre… et à espérer . Un soir, au moment où je me couchais, mon père fit allusion à certain objet roulant, mais chut…il fallait être sage ! Du coup, j’eus bien du mal à m’endormir, tellement j’étais empli d’une joyeuse excitation. Les jours suivants, j’oscillai entre espoir et crainte et quand le jeudi arriva, je fus soulagé de constater qu’Elle avait disparu de la vitrine.Il y avait donc des chances qu’Elle soit dissimulée dans un recoin secret de notre maison.
Le soir de Noël arriva enfin. Comme d’habitude, réveillon en famille, puis avant d’aller nous coucher, nous avons déposé religieusement nos bottines, cirées et lustrées pour l’occasion, au pied du sapin clignotant ; mon père esquissa un mime qui était une allusion évidente à ma bien-aimée et je n’eus plus qu’une hâte : être au lendemain matin.
Toute la nuit, j’ai roulé sur les allées du parc avec Elle, mais hélas, trois fois hélas, mes rêves ne se sont jamais concrétisés. Lorsqu’enfin, le matin venu, nous sommes entrés dans le salon pour découvrir nos cadeaux, je remarquai certes une silhouette familière enrobée de papier beige, mais un affreux doute m’envahit quand je m’en approchai. L’objet déballé, je ressentis une immense déception : une ridicule patinette en plastique, même pas rouge ! Adieu somptueux carénage, roues chromées et gros pneus ! J’étais anéanti !
Mes parents n’ont pas compris pourquoi j’ai pleuré, puis boudé durant toute la journée, refusant de toucher cette patinette qui sera finalement récupérée par ma sœur. Pour eux également, ce ne fut pas un joyeux Noël !
Je n’ai jamais revu ma bien-aimée ; et même si, je l’avoue, j’ai gardé ma fascination d’enfant pour le rouge et le chromé, cela restera pour moi un rêve inaccessible…
Depuis mes multiples désillusions enfantines, j’ai demandé à mon entourage de ne plus m’offrir de cadeaux, je préfère m’offrir un cadeau quand j’en ai envie. J’en avais marre de faire semblent d’être content.
C’est l’un de mes plus anciens souvenirs, et l’un des premiers chagrins dont je me souvienne. Je ne puis dater précisément cet évènement, probablement 1952, mais c’est l’instant et le chagrin qui comptent.
J’avais à peine trois ans. Après un hiver passé chez mes grands-parents à N., car mon père, veuf de fraîche date, ne pouvait s’occuper de moi, j’étais de retour à L., dans cet appartement de la place M. Cette habitation me paraissait étrangère ; j’avais dû y passer quelques semaines un an avant, mais je n’y sentais pas la vie quotidienne d’un lieu habité.
Il faisait nuit et froid. Nous venions de la gare. Je n’eus pas le loisir d’investir les lieux plus avant, puisque l’heure tardive conduisit mon père et mes grands-parents à me coucher tout de suite dans le lit qui m’avait été préparé.
La pièce était grande et sombre. Avant de me coucher, j’aperçus, sur l’étagère la plus élevée d’un immense placard qui occupait toute la hauteur du mur – le plafond était à trois mètres ! – et dont la porte était restée béante, quelque chose que je voulus immédiatement posséder. Orphelin de mère, déraciné entre N. et L., j’avais besoin de ce que les praticiens de la psychologie infantile appellent un objet transitionnel pour apaiser, à cet instant une sorte d’angoisse. C’était en effet le seul élément, dans cette chambre glacée et encore impersonnelle, avec lequel je me sentais entrer en résonance.
C’était un jouet de bois, un cheval tractant une carriole rouge et blanche. Outre cette complicité que déjà je vivais avec cet attelage, il était évident qu’il m’était destiné, aucun autre enfant n’étant présent.
Je réclamai le cheval et sa charrette. On m’opposa un refus, au motif qu’il était l’heure de dormir. Sans doute me rassura-t-on en me promettant que dès le lendemain j’entrerais en possession du jouet, mais je n’entendis probablement pas cette promesse. Je le voulais maintenant.
Je me souviens avoir réitéré ma demande plusieurs fois, finissant par capituler devant les refus successifs des adultes, qui étaient les plus forts.
J’éprouvai alors une peine, un chagrin, qui me parurent le comble du malheur. Je ne comprenais pas les raisons du veto, j’avais l’impression que l’on me spoliait, avec la dernière injustice, de mon bien.
Je m’endormis, je crois, assez vite, assommé par la fatigue du voyage. On me remit très certainement le jouet le lendemain, je ne m’en souviens pas. Qu’importe, seul compte dans ma mémoire l’immense chagrin de cette incompréhensible frustration.
— Alors, Toto ? J’attends.
Ma mère était à bout de nerfs. Moi aussi, j’avais envie de me le faire. Cela faisait une heure que l’on était, elle et moi, les yeux dessus.
— Elle t’a possédé, Toto. « é » ou « é-e » ?
— Euh… « é-e »
— Qui est possédé, Toto ? j’attends.
Le ton de ce dernier « j’attends » signait la fin de la récréation, je devais absolument ne pas me tromper entre le sujet et sa chose, son objet qu’elle l’appelait, avec son complément. Mais moi, je ne voyais qu’elle, comme Mademoiselle Conio, quand elle me pose le même genre de question au tableau. Sa longue jupe sous les genoux, trop chou, bijou, joujou, genou. Je me repassai le film interdit de regarder dessous.
— On met un « x », maîtresse.
— Bien, Toto.
Mais là, il s’agissait, avec maman, d’un objet et son complément qui se jouaient de moi depuis une heure derrière la phrase : « Elle t’a possédé, Charlie ! »
— Qui est possédé, Toto ? j’attends.
— Elle ? … Euh, non… t’a ? Charlie ? … C’est Charlie !
Je passais en revue toutes les réponses possibles jusqu’à l’approbation de la grimace sur son visage.
— Charlie, oui. Bien ! on va finir par y arriver. Donc on l’accorde au ?
Je ne voyais pas du tout où elle voulait en venir avec sa corde. Je tentais en vain.
— Au… au cou ?
Que n’avais-je pas dit.
— Tu m’exaspères, Toto ! Il est dix-neuf heures, il fait beau, c’est les vacances, tous tes copains sont à la piscine en train de jouer. Et toi, tu n’es pas fichu de répondre à une page du cahier de vacances de ta sœur qui est en CM1 alors qu’à la rentrée tu vas au collège. Moi j’abandonne, je te laisse avec ton père, dès qu’il aura fini sa partie de boules. Moi, j’ai ma dose ! J’ai aussi le droit d’être en vacances !
Avec papa, on s’est vite accordés qu’ « Elle » était le sujet de tous les problèmes, ceux de Charlie et des nôtres à nous pourrir les vacances. Et il m’a emmené retrouver ses potes au club du camping, où il m’a offert, comme à eux, un perroquet sans pastis, qui a avait fraîchement le goût d’une menthe à l’eau.
Mais dans le mobil-home, la nuit, « elle » est revenue, vêtue de la jupe de mademoiselle Conio. La phrase et son objet n’avaient pas fini de me posséder.
La randonnée démarre. Les montagnes se dessinent dans le ciel bleu azur. La température est encore agréable.Dans les prés vert tendre les fleurs explosent en multiples formes et couleurs éclatantes.
Je m’arrête brusquement et tends le bras vers ce rocher dressé telle une grande aiguille, ou plutôt tel un menhir légèrement bossu. Sur son sommet est posée une forme qui attire irrésistiblement mon regard. Le groupe est stoppé autour de moi.
Alors tu as vu le loup !
Regardez, c’est un oiseau.
Ça ne bouge pas, c’est une pierre.
Non, c’est un rapace. Regardez bien.
Après plusieurs minutes à fixer l’objet, certains sont d’accord avec moi. Les autres affirment que c’est un vulgaire caillou.
Quoiqu’il en soit, on ne va pas prendre racine. Allez en marche Maguy.
Quoi, Maguy !! Je suis Maguelonne et vous demande de me respecter.
Une main couleur jambon « nitrité » avec ses doigts boudinés se pose sur mon bras.
Allez viens, on verra ce soir si l’objet est toujours là.
Moi je reste ici . Vous me reprendrez au retour.
Bien volontiers, s’écrie le chef avec un soupir de soulagement.
Comme ils sont bêtes. Ce groupe est un troupeau d’abrutis avec un camembert coulant en guise de cerveau. Je fais semblant d’être comme eux mais je n’y arrive pas. Je ne veux pas être une Maguy, ni une Marguerite, ni une Claudine… Je ne serai jamais comme eux.
Je m’assois en tailleur et fixe la forme sur le rocher. Je sens, je sais que c’est un faucon au plumage gris bleuté. Il est fier et majestueux, ne bouge pas d’une plume. Il me fixe avec son œil noir impénétrable.
Je retire le poulet de mon sandwich et le tiens dans ma main droite au bout de mon bras tendu. Et je ne bouge plus d’un poil. Le temps passe et le soleil à son zénith tape sur mon crâne. Et mon cerveau devient comme un œuf au plat trop cuit dans sa poêle.Même une huître raisonne plus que moi. Mais je ne bouge toujours pas !
Lui non plus. Il est toujours insolent, farouche. J’attends qu’il vienne se poser sur mon bras, me racontez toutes les choses que connaît un faucon. Peut être qu’il n’emmènera loin d’ici. Je suis légère, légère puisque toute desséchée.
Ah Maguelonne, tu es encore là. On rentre maintenant.
Je suis paralysée, pétrifiée, Bouddha de granit. Après concertation, un randonneur attrape mon coude gauche, le chef se saisit de mon bras droit toujours tendu. Ils me soulèvent et me ramènent à l’hôtel.
Qu’est ce qu’on va en faire ?
On va la tremper dans une baignoire d’eau bien chaude pour la ramollir et on la renvoie à l’asile.
Ah, cette jeunesse, cet espace incertain où l’on joue aux billes avec son ours et aux grosses autos avec son père. Ça se passait plutôt correctement, vu de mon petit chez moi. Je ne sais quel hasard m’avait porté là. D’habitude, en rentrant de l’école, je reniflais le marchand de bonbons, je filais jusqu’au boulevard, le traversais et entrais dans mon quartier, cette zone cartographiée dans ma petite tête entre le pont, la station-service et les feux de signalisation.
Et là, attiré par l’agitation, le bruit sourd des fausses joies, je me retrouvais sous ses jupes. Les jupes d’un grand manège où s’entassaient des rires et des cris. Moi, déjà curieux du dessous des choses, j’explorais du regard ce petit monde à l’envers agitant des pieds, comme pour me saluer. Puis la pesante machinerie du manège se mit en route. C’était un genre de chenille un peu ridicule se trémoussant d’une fausse collinette à l’autre. Ça prenait de la vitesse simple comme tout ce qui tourne en rond.
C’est alors que de ce ciel de toiles tendues sur de la ferraille boisée me tomba une pluie. Comme des étoiles, des petites, des grosses, des lumineuses et des cabossées. Mais les étoiles tombaient sur le pavé, rebondissaient sur le voisin. Ce n’était pas une pluie d’apocalypse, juste une averse soudaine et rafraîchissante. Autour de moi, un nombre incertain de piécettes me faisait la ronde. Vu mon peu d’argent de poche disponible dans ce monde d’après-guerre, je ramassais le tout, m’en fourrais les poches et sortis dans la foule.
Je tournais et retournais dans la ducasse, essayant de semer la mauvaise conscience tentant de me faire un croche-pied. Je passais devant le marchand de barbe à papa, non, j’avais déjà celle de mon père. Devant l’enrouleur de pommes d’amour, non, je me méfiais déjà des rondeurs trop sucrées.
Je ramenais mon magot à la maison et le planquais sous mon matelas. Après vertes réflexions de mon âge, je décidais de dépenser mon trésor, chaque soir, à la sortie de l’école chez ce marchand de bonbons dont je n’avais jamais pu passer la porte.
J’étais encore bien jeune, je n’imaginais pas une autre guerre. Je m’inquiétais un peu de ces gens, jetant l’argent par la poche, pour un petit tour d’illusion les obligeant, dès le jour suivant à se ré-atteler au grand manège du travail. Et qui, en panne de loisirs gratuits, repartiraient à la guerre.
La chirurgienne prend son temps et le meilleur de sa pédagogie pour m’expliquer ce qui va m’arriver. Devant elle tout une collection de formes, de métaux, de matériaux divers. Brrrrrrr… Je suis fasciné, troublé, j’en tremble. Il me semble entendre mes os claquer des dents pourtant je n’ai ni froid, ni peur.
Elle choisit de ses doigts effilés et la désigne : voila, ce sera celle-là, la mieux adaptée, la plus efficace, tout a fait celle qu’il vous faut.
Cette pièce je la veux. Séduit, je m’exclame, oh! comme elle est belle, si brillante dans son métal poli. Ah c’est bien qu’elle vous plaise d’autant plus qu’elle vous accompagnera jusqu’à votre dernier jour.
C’est vrai quelle étaient jolies, tant la chirurgienne que la prothèse. Tenté, ça oui, mais entre les deux il me fallait choisir. La raison et ma douleur me firent donner priorité à la petite pièce de métal.
Elle ressemblait a une boule de glace sur son cornet ou mieux, à une balle de golf perchée sur son tee.
Comme elle sera bien tout près de mon cœur, elle s’y reposera en paix après avoir assuré à mon épaule les rotations et pendulaires indispensables. Elle aura donné un sens à mes derniers vieux os qui font que l’on se casse si facilement la figure. Elle n’en mourra pas pour autant le jour venu de ma crémation.
On me l’a dit, je l’ai lu aussi : ces pièces de titane sont de petits trésors, repêchées parmi les cendres elles reprennent vie à leur place, dans d’autres hanches, genoux, épaules… Immortelles, elles.
J’avais 7 ans. Mon amie Lucie vivait dans une très belle maison. Elle avait une grande chambre et un coffre rempli de déguisements. Elle avait un rire cristallin et un air désinvolte que je lui enviais dès qu’elle prit place dans la classe près de moi. Tout paraissait si simple pour elle. Je ne pensais même pas que l’on pouvait être aussi insouciant. Le jour où au hasard d’une énième séance de déguisement, elle sortit sa boite à bijoux. Je fus immédiatement hypnotisée par une paire de boucles d’oreilles à clips. Elles étaient bleues à points rouges et dansaient au creux de ses mains. Quand elle me les tendit je n’en revenais pas. Je les caressais du bout des doigts, elles étaient d’une douceur incomparable. Je me tournais vers le miroir et les portais à mes oreilles. Une chance qu’elles soient à clipper car je n’avais pas les oreilles percées. Je voulus tout de suite qu’elles soient à moi et sitôt Lucie retournée, partie danser devant le miroir dans sa robe à volants je dérobais les boucles que je glissais dans ma poche le cœur battant.
Le soir, en arrivant chez moi, je fouillais au fond de ma poche pour en sortir l’objet du délit. Là au creux de ma main, les boucles semblaient soudain moins étincelantes, fardées du poids de ma culpabilité. Si mes parents savaient ! Je compris soudainement que je ne pourrais jamais les porter. Il me faudrait justifier cette nouvelle acquisition. Et comme je n’avais pas d’argent, il me faudrait élaborer un scénario, bien trop compliqué. Ils ne me croiraient pas si j’expliquais que Lucie me les avaient données et surtout mettraient un point d’honneur à remercier ses parents, ce qui étaient bien trop risqué. Je leur trouvais une place dans une petite boite au fond du tiroir de ma table de nuit et les regardaient quelques fois, toujours avec la peur au ventre d’être découverte. Mon cœur s’emballait alors et le poids de la honte pesait toujours plus sur mes fragiles épaules. Je me détestais soudain. Je replaçais les boucles dans leur boite au fond du tiroir et décidais même quelques années plus tard de m’en débarrasser. Je les jetais avec ma déception et bizarrement, constatais quelques années plus tard, qu’après cela, je n’eus plus jamais ce sentiment urgent de posséder quoi que ce soit, qui plus est, qui ne soit pas à moi.
Aujourd’hui, en cette fin d’hiver, j’ai 15 ans. Une parente et amie me propose d’aller choisir mon premier sac à main.
Je n’ai pas d’idée précise sur le type de modèle qui me conviendrait. Nous regardons les vitrines du boulevard Saint Michel à Paris.
Je ne saurais évoqué les différents styles de sac vus : couleurs, matières, tailles, formes…
Je ne me souviens que de celui que je choisis. Il est dit sac « saddle » en cuir pleine fleur naturelle sans grain, très doux au toucher, un rabat complet sur l’avant et une bandoulière. Le cuir est épais, bordeaux, la structure rigide et les trois compartiments composent son intérieur de même texture.
Je ne vois que son cuir brillant et sa couleur chaude. Je passe les doigts sur le rabat et réalise qu’il a la même température que moi, il est lisse et je ne peux m’empêcher de respirer le parfum de sa peau. Je ne souhaite tenir que lui. Je ne veux que lui. Sa taille moyenne me convient très bien. J’imagine y mettre tous mes trésors, comme les vraies femmes. Je rêve d’avoir des cartes de toutes sortes que je regrouperai dedans. Pour le moment, je n’ai qu’une carte de transport et celle signée par Maurice Herzog attestant de mes capacités sportives, comme mes camarades de classe.
Je mettrai dans mon sac, les clés, un mouchoir et, en attendant d’avoir de vraies cartes, je me fabriquerai un livret de famille imaginaire, un permis de conduire, une carte grise et peut-être un chéquier pour jouer à la grande.
Ce sac est le plus beau cadeau que je reçois. Non pas en termes de valeur marchande mais en tant que refuge secret qui ne sera qu’à moi, comme un terrier dans lequel je ne pourrai entrer mais qui, néanmoins, protègera tous mes rêves et secrets.
Je vais donc vous raconter cette fois où mon regard s’est posé sur l’objet en question :
J’étais désemparée… que faire ?
Prier ? Ma foi, ça peut toujours servir mais je n’avais pas la tête à ça.
Crier ? Je n’y arrivais pas.
Réfléchir ? Pourquoi pas ? Mais le contexte ne s’y prêtait guère.
C’est alors qu’il m’est apparu : tentant et excitant. Énorme et luisant.
– Mais Non (me disais-je), faut que je résiste !
Impossible de le quitter des yeux.
La fascination opérait et je sentais bien que je n’étais plus maître de la situation.
C’est alors qu’involontairement, je dis bien « involontairement », je m’en saisis et que je l’enfonçai dans la jugulaire d’Alfred.
Voilà Monsieur le Juge comment j’ai été manipulée par l’objet.
On est bien peu de choses n’est-ce-pas ?
Des cris comme des balles, des hurlements pour mieux saisir le poids de la vie, l’homme aimait cela depuis toujours : sentir vibrer en lui l’instinct bestial de la révolte.
Des pavés dans la gueule, des panneaux en guise de lance, des flammes pour exulter, humer les phéromones d’anciens guerriers mongols et hurler la vie.
Parce que le sang était l’apanage des jeunes pour toujours ! Il était d’inutile de chialer sur son confort matériel et d’engager les procédures de justice. L’argent reviendrait toujours, la jeunesse jamais. Alors, j’étais presque heureux de voir la jeunesse mettre le feu à ma poubelle, je leur tendais même un briquet et quelques cocktails explosifs pour perpétuer encore un peu ce joli feu d’artifice qui serait trop vite éteint.
Un bruit d’éclat foudroyant comme un éclair suivit d’une pluie de cristal vint réajuster ma réalité, la vitrine du magasin devant lequel j’étais si souvent posté venait d’exploser.
J’avais devant moi un choix cornélien : m’introduire ou fuir.
Il y avait là de quoi se sustenter, remplir mon sac à dos jusqu’à la gueule, m’emparer d’un joli butin et m’envoler sur les ailes d’un oiseau avec quelques poètes dans l’escarcelle.
Une petite voix d’enfant de chœur me susurrait de m’éloigner, peut-être même de ramasser les bris de verre et d’alerter la sécurité, l’autre plus coriace m’incitait à profiter, à prendre ma part du gâteau, à jouir de l’instant présent, une telle aubaine ne reviendrait pas de sitôt ! On avait tendance à formater les cerveaux avec de la technologie High-Tech, j’avais eu peur qu’on formate aussi les rébellions et que seul les petits coups de gueule sur les réseaux sociaux suppléaient les actes d’incivilités.
J’étais heureux de voir toute cette jeunesse scandait sa hargne, il restait encore de l’espoir : Viva Zapatta m’écriais je !
Fort de ce modeste cri, j’entrais dans la boutique, marchais sur le cristal à petit pas et jetais un œil alentour tel un vautour aux aguets. J’étais seul, l’endroit ne semblait pas opportun pour les badauds, pas de Nike, ni d’artifice pimpant …
Je commençais déjà à saliver, un mélange d’adrénaline et d’ocytocine sustentait frénétiquement mes globules rouges, je jubilais, j’étais à deux doigts de l’orgasme, il me fallait prolonger cette attente, attiser encore et encore le désir…
Mes doigts effleuraient tous ces butins à portée de main, je marchais les yeux fermés pour mieux m’enivrer de ces trésors. J’osais parfois, un peu plus, caresser un dos, observer du coin de l’œil, respirer les parfums, imaginer les histoires toutes plus folles les unes que les autres….
Lorsque j’ouvris de nouveau les yeux, il était là devant moi, tel un esthète grec détaché spécialement pour moi.
Je fus femme, je l’embrassais sans réfléchir, avec la fougue de la jeunesse, jusqu’au sang, jusqu’à la brulure, jusqu’au fond de l’âme, mais le destin m’avait fait homme alors je me tins coït.
Je tournais la tête, observais frénétiquement alentours, aucun vigil, rien ! Juste lui et moi !
Ce fut ma bouche qui osa, j’embrassais son torse comme s’il fut le christ, mes mains devinrent prises de spasmes, elles envisageaient déjà le futur, les nuit torrides, la justesse de chaque pensée.
J’ouvrais mon sac, la gueule béante, et l’emportais avec moi.
Une fois kidnappé, je courrais, déambulais à la vitesse de la lumière dans les rues en feu, sautillant parfois sur les marches du trottoir, amoureux fou….
Lorsque j’arrivais chez moi, émoustillé comme un gamin qui va pouvoir jouer avec son cadeau. je m’emparais d’une bouteille de champagne pour fêter l’événement, sortit de flutes de cristal , les emplit avec délicatesse et porta un toast à ma conquête :
Sur la table resplendissait l’objet de mon délit, offert au monde, prostitué éternelle de la Un bruit de verre foudroyant comme un éclair et une pluie de cristal à mes pieds.
Un bruit de verre foudroyant comme un éclair et une pluie de cristal à mes pieds.
beauté, il me confia les mots suivants :
« Très peu de vivants et beaucoup de morts dans cette vie _ mort étant celui qui ne se lâche jamais et ne sais pas s’éloigner de soi dans un amour ou dans un rire «
Sur son torse était gravé « l’éloignement du monde »
Christian BOBIN
A cet instant où mon regard s’est posé
Sur la rivière
Je suis devenue eau
Affranchie, animée
A cet instant où mon regard s’est accroché
Aux branches
Je suis devenue arbre
Imparfaite, irrégulière
A cet instant où mon regard s’est levé
Vers le ciel
Je suis devenue lune
Fantasque, ondoyante
A cet instant où mon regard s’est étendu
Au loin
Je suis devenue montagne
Redressée, amarrée
A cet instant où mon regard s’est détourné
Du monde
Je suis devenue air
Indistincte, gracile
Cœur palpitant, gorge sèche, je me rends rend vers l’objet de ma convoitise : il est là fidèle au rendez-vous estival, il attend…
Dilemme de l’instant : laquelle choisir parmi toutes ces belles qui me font de l’œil ? Et je la découvre, elle, l’élue, suspendue par sa queue fragile, qui joue l’innocente, consciente du désir qu’elle perçoit. Ma main s’approche, hésitante. Mes yeux ne voient qu’elle, toute ronde et charnue comme les fesses d’un nourrisson, elle s’offre à mon désir. Sa peau carminée est si brillante que le ciel s’y reflète. Je la détache avec précaution pour ne pas blesser cette princesse, elle a droit à certains égards. Une goutte rouge sang sourd à sa base, promesse du plaisir gustatif attendu. Alors n’y tenant plus, mes lèvres se posent sur la chair toute chaude gorgée de soleil en un baiser voluptueux.
Mais la langue hésite à parcourir la rondeur cirée du fruit. Je la suce délicatement en la faisant rouler entre les dents, avec un afflux de salive incontrôlable. Je me délecte de la magie de l’instant.
Mes dents croquent délicatement un morceau. La chair craque sous la morsure. Elle explose en libérant un jus sucré et poivré qui se répand au fond de ma bouche. Je n’entends plus l’alentour. Ni les chants des oiseaux ni le bourdonnement des abeilles n’arrivent à me détourner de cette sensation extatique. C’est un nectar qui coule dans ma gorge. J’en redemande et je mords sauvagement cette chair tendre et fondante. Mes dents viennent buter sur un petit noyau, dur, incassable que je vais devoir recracher. Je termine cette gourmandise végétale en gobant ce qu’il reste. Mais il est trop tard : le sucre a libéré les endorphines. Alors, saoulé par cette succulence, je poursuis la dégustation avec impatience.
Quelle déception ! Celles qui attendent d’être croquées ne sont que de pâles esquisses de la première : les molles aqueuses, les rosées peu sucrées, les raides de maturation non aboutie… Rien ne peut égaler le premier choix, fruit du hasard ou coïncidence ?
Tiens, ma langue discerne un élément mou, fade et élastique. Mais qu’est-ce ? je recrache le tout dans ma main : horreur, un asticot blanchâtre se tortille au milieu d’une purée vermillon ! C’est vous dire combien je me souviens de l’irrésistible pouvoir d’attraction d’une cerise sur moi, la première fois.